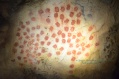![Carte N°1. Localisation de l'Archipel de San Andrès, Providencia et Santa Catalina dans la mer Caraïbe, source : [Ratter, 2001, p.94] Carte N°1. Localisation de l'Archipel de San Andrès, Providencia et Santa Catalina dans la mer Caraïbe, source : [Ratter, 2001, p.94]](https://www.anthropoweb.com/photo/art/default/3077196-4389047.jpg?v=1308820723)

Les habitants traditionnels de l’île, qui se sont auto-nommés les « raizales(1) » mais qui sont aussi désignés comme les « insulaires », sont l’objet d’un effort de « colombianisation » mené par le gouvernement et dont l’outil principal sont les colombiens continentaux, ou « pañas » de langue espagnole et de religion catholique, raison pourquoi le point de vue des continentaux est important: Le discours privilégié des droits des peuples autochtones est dominé par les insulaires. Le propos de cet article est de mettre en lumière cette autre parole qu’est cette des « pañas », trop souvent oubliée et presque muette, pour qu’elle nous révèle d’autres chemins vers la compréhension de cette île caribéenne minuscule et complexe.
La géographie et le contexte socio-historique sont des aspects très importants de la vie des colombiens continentaux sur l’île. Ils éprouvent des difficultés dans leur vie après leur arrivée à San Andrés. D’un côté ils peuvent ressentir une sensation de captivité sur l’île. De l’autre, ils vivent une exclusion historique du fait de ne pas appartenir ni partager la tradition insulaire, qui se manifeste par la langue, les festivités, les rites et les croyances propres aux raizales. Malgré cela, les continentaux ont établi des réseaux sociaux et culturels comme moyen d’adaptation et une organisation spatiale particulière dans des quartiers majoritairement continentaux.
Comment un terrain devient-il donc un territoire? Le fait d’appropriation est en lui-même le moyen par lequel une population exerce sa dominance sur la terre et ses ressources. Cela est essentiel vue que dans la lutte pour les obtenir, l’environnement, l’économie, la politique, la culture et même la société vont entrer dans cette compétition. Ces dynamiques de compétition et d’appropriation servent à comprendre les actions des humains qui conduisent vers un acte typique de la culture [Wilson, 1995 ; Vasco, s.d] c’est-à-dire la transformation sociale et historique d’un milieu naturel.
Au moment où un contrôle est exercé sur un territoire, des limites vont aussi se former. Cela permet de construire et de maintenir une société, tout comme de transmettre la culture grâce aux systèmes de la parenté, aux pratiques religieuses, à la langue, aux rites et à d’autres marques identitaires qui renforcent l’idée de groupe. Le territoire devient alors l’axe central pour la continuité du groupe et dans le cas de San Andrés, c’est un des points capitaux et délicats du conflit entre les différents résidents [Barth en Poutignat, 1999].
Dans son rapport sur la problématique du territoire dans l’Archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina publié en 1998, le POT (Planification pour l’Ordre Territoriale) explique que le problème d’accès à la terre sur l’île de San Andrés est dû à une mauvaise occupation du territoire. Le rapport se réfère notamment à l’expansion de quartiers sans services, l’insuffisance d’espaces publics et « la présence conflictuelle du multiculturalisme dans le territoire », outre l’exclusion mutuelle de groupes différents et la perte de richesse de leurs expressions culturelles [POT, 1998].
Lorsqu’il est question du problème démographique de San Andrés, il est commun de faire des reproches aux vagues migratoires, particulièrement celles provenant de la Colombie, qui depuis les années 1960 ont joué un rôle important pour le peuplement de l’île, en oubliant d’autres facteurs comme par exemple le pourcentage de natalité très élevé. Ces migrations ont conduit également aux mélanges culturels et familiaux, ainsi qu’à une tension entre la population traditionnelle et la population immigrée, phénomène répétitif dans la Caraïbe [Benítez, 1998].
La réponse de l’État a été de créer des entités publiques pour résoudre le problème de logement. Parmi les entités se trouvent l’Institut de Crédit Territorial (ICT), le Fond du Département pour le Logement Insulaire (FIPVI), les prêts de la Banque Centrale Hypothécaire (BCH), l’INURBE (Institut Nationale pour le Logement d’intérêt social), et les Assemblées des Action Communales (JAC). Simultanément, l’appropriation illégale des terrains (pour les immigrés) qui deviendront des quartiers subnormaux et illégaux.
A mesure que la population immigrée s’établit sur l'île (suite à une migration de classe) et s’organisa elle-même, la population raizal participe à les structurer symboliquement en tant que peuple, à partir de l’idée qu’il existe une homogénéité « paña ». C’est ainsi que la notion de l’« autre » a pris forme pour les résidents natifs.



Comme nous l’avons déjà mentionné, l’image que le raizal se fait des continentaux est d’un groupe homogène. Cette vision ne tient pas compte des diverses origines ou cultures des continentaux, mais fait d’eux tous des étrangers, tous des « Spanish Man »(2). Cependant, un regard plus attentif serait susceptible de trouver une immense hétérogénéité au sein de la population continentale, qui s’exprime dans la vie des quartiers et dans la quotidienneté, et qui, avec leur caractéristique commune d’être migrants, est ce qui leur apporte une identité légitimatrice face aux insulaires [Agier, 2000].
Mais qui sont donc ces « pañas »? Nous avons creusé cette question lors de notre travail de terrain à San Andrés avec des résidents du continent colombiens venus principalement des villes de Carthagène, Barranquilla et Córdoba. Nous avons aussi noté la présence, même s’ils étaient moins nombreux, de continentaux venants d’autres villes comme Tulua, Cali, Medellín et Bogotá, ainsi que du nord du Département d’ Antioquia et Santander. Tous ceux-ci (les personnes avec qui j’ai travaillé) forment trois générations de « pañas » : la première de migrants entre 40 et 60 ans; la deuxième inclus des migrants tout comme des personnes nés sur l’île qui ont entre 15 et 30 ans et la troisième est composé d’enfants de moins de 14 ans, tous nés à San Andrés.
Les « pañas » de 40 ans sont arrivés à San Andrés avec leurs familles vers la fin des années 1980. Les raisons pour lesquelles ils décident de migrer ont un rapport étroit avec les mauvaises conditions économique et/ou sociale qu’ils ont souffert dans leurs villes d’origine et avec la croissance économique que connaissent les îles colombiennes grâce à la circulation d’argent issu du trafique de drogue et de la construction d’une grosse infrastructure touristique. La décennie des années 1980 est donc le point de départ du développement de la population « paña », qui retient notre attention à présent.
En observant la mobilité vécue par les résidents de deux quartiers (Cuidad Paraíso et Morris Landing), nous pouvons comprendre pourquoi la relation entre leurs habitants et le terrain est un aspect considérable de la construction d’un sens de propriété à San Andrés d’un côté, et des identités individuelles et collectives de l’autre [Balibar, 1990]. Au moment de vivre cette relation homme/terre, les continentaux ont éprouvé des tensions qui ont été source de différentes stratégies d’intégration mises en œuvre simultanément. Ces stratégies basées sur le nouveau rapport homme/terre sont essentielles à la perception des processus d’assimilation et d’appartenance à la société insulaire.
Il est intéressant d’étudier l’effet de ces processus sur les jeunes puisqu’ils éprouvent des processus de vie singuliers. Les jeunes de 18 ans qui sont nés sur le continent tout comme les plus petits nés sur l’île ont été élevés dans le monde insulaire. Ces générations ont constamment été exposées aux multiples influences, avec d’un côté leurs parents dont les idées continentales sont un peu éloignées de celles des insulaires, la vie quotidienne des quartiers, et le système pédagogique. De l’autre côté, leur scolarité et leurs amitiés sont encadrées par la vie insulaire qui les dote des caractéristiques sociales et culturelles différentes de celles de leurs parents qui se manifestent dans la nourriture, la musique, la mode, la langue, entre autres choses. Ceci montre que cette nouvelle génération est capable d’adopter des comportements spécifiques et d’intérioriser de multiples représentations culturelles.
La musique est une forme d’identification très intéressante à San Andrés, surtout pour cette population de jeunes. Tout comme les courses de cheval ont été remplacées par celles de motos, le vieux bal de la « mazurca » et le « cuadril » on été remplacés par la champeta et le vallenato. Ces deux derniers genres musicaux ainsi que le « reggaetón » font à présent partie du répertoire des jeunes de San Andrés. C’est un exemple parfait de la manière dont se vivent les changements sociaux, c’est-à-dire de manière évolutive. Contrairement aux adultes, qui le disent eux-mêmes, sont venus « déjà formés», les jeunes cherchent, imitent, refusent, et adoptent les caractéristiques ou normes qui pourront les identifier avec quelqu’un ou avec quelque chose en particulier.

Arrivés comme jeunes adultes, les migrants de la première génération ont conservé ce que nous pourrions appeler les « vieilles coutumes », comme par exemple la langue espagnole, les formes sociales et l’organisation spatiale du continent, ainsi que la religion catholique avec ses célébrations de fin d’année comme les « novenas » (des réunions familiales durant les neufs jours précédant Noël, où les gens prient, chantent et mangent des plats spéciaux). Tous ces aspects augmentent la résistance au moment de l’assimilation.
Certes, les quartiers continentaux sont un vrai exploit qui a permis à cette population de fortifier ses traditions et ses représentations culturelles même si elle a dû souffrir des processus de mobilité et d’adaptation. Mais c’est surtout la transformation de simples terrains en territoires qui a permis cet ancrage physique et psychologique de chaque migrant dans son nouvel environnement. Cette première génération se souvient encore de son histoire et de la vie d’antan, ce qui cause une réminiscence constante qui caractérise leur vie quotidienne dans les îles. Ainsi, l’appropriation d’un bout de terrain devient le moyen essentiel pour la reconstruction personnelle et de groupe. De plus, l’appropriation produit une sécurité grâce à laquelle les gens peuvent se soutenir et se sentir comme une partie d’un tout.
Ce tout peut être vu comme le tout « paña » car comme nous l’avons vu préalablement, les quartiers sont composés le plus souvent par gens du continent, catholiques et hispanophones. Les habitants de ces quartiers symbolisent les morceaux du puzzle des habitants « pañamanes » sur une île de traditions et coutumes anglo-africaines.
Il est d’autant plus intéressant d’expérimenter l’isolement de ces quartiers que le territoire est déjà isolé de par son insularité. Trouver ces quartiers est un défi géographique. Loin du centre-ville, avec de mauvaises voie d’accès et enfouis sous une dense végétation, ces secteurs ne sont pas enregistrés sur les cartes mentales des habitants de l’île, ni continentaux ni raizales.
Vu la taille très réduite de San Andrés, ceci est plutôt surprenant et il devient pertinent de se demander la cause apparente de cet isolement. Est-ce une stratégie des continentaux ? Ou bien le conflit entre cultures oblige-t-il à la division de l’espace ? Comment un quartier comme Morris Landing, qui est formé de plus de 1200 habitants, peut-il passer inaperçu ? Que doit-on penser du credo des populations insulaires d’après laquelle « nous sommes tous une famille » ? [Wilson, 1995 ; Ratter, 2001].
Ciudad Paraíso et Morris Landing sont une île à l’intérieur d’une île, où les habitants se connaissaient après avoir partagé plusieurs années ensemble et construits leurs maisons les uns à côté des autres. Ces deux quartiers sont des lieux construits avec beaucoup d’effort en suivant la nécessité impérieuse ressenti par leurs habitants de posséder un terrain où s’installer. Le fait d’être loin du centre-ville et des endroits traditionnels raizales aide à créer un « chez soi » à l’intérieur de San Andrés, où les gens, les constructions, les activités, les nourritures sont totalement « pañas ». En recréant la vie continentale, les « pañas » ont créé une autre l’île.
Parlons à présent de la « mobilité symbolique de la culture » [Avella, 2001], concept selon lequel une personne ne perd pas ses origines bien qu’elle se déplace parmi d’autres cultures. Suivant cette logique, le sanandresain sera toujours sanandresain peu importe l’endroit où il se trouve, de même qu’une personne de Carthagène continuera à l’être à San Andrés. Or, malgré cette expression d’identité statique et unificatrice, le groupe ou l’individu migrant peut s’approprier des valeurs essentielles à l’identification qu’il trouve chez l’autre. Dans ce cas, il s’agirait de valeurs associées à la liberté, le travail, la sûreté économique, la tranquillité familiale et psychologique, et enfin le prestige d’avoir une propriété.
Cependant, le concept du territoire varie pour les différentes populations qui habitent l’île. D’un côté, la communauté sirio-libanaise, surnommés « Turcs » par les autres habitants, n’émet aucune revendication culturelle ou territoriale sur l’île. À l’exception d’une soixantaine de familles qui y résident de manière permanente, les autres membres de cette communauté sont une population flottante qui ne reste à San Andrés que quelques années.
D’un autre côté, il y a les continentaux qui, comme nous avons vu, aspirent à un terrain où construire leur maison et s’établir pour ensuite se faire une place au sein du milieu social et culturel de l’île. Jusqu’à présent cette population, bien que nombreuse, ne fait aucune revendication, ni socioculturel ni politique.



Notes
1. On appelle raizal le groupe ethnique anglo-africain traditionnellement établis dans l’Archipel de San Andrés, Providencia et Santa Catalina, avec langue, culture, histoire et ancêtres propres.
2. Pour les insulaires, le terme « Spanish man » signifie « homme sans caste », la plus basse condition de l’être humain. Les insulaires utilisaient cette expression pour se référer aux hommes espagnols dès leur arrivée sur l’île en 1793. Aujourd’hui, grâce à l’apocope Caraïbe l’expression anglaise a donné le mot « Pañaman » ou simplement « paña » [Benítez, 1998, p. 244-245].
BIBLIOGRAPHIE
Agier M. [2000], « Las antropologías de las identidades en las tensiones contemporáneas », in Revista Colombiana de Antropología, Vol. 36 Enero/Diciembre.
Avella F. [2001], « Proceso Identitario y Pensamiento Caribe », in V seminario internacional de Estudios del Caribe, Cartagena, julio 30 a agosto 3 de 2001.
Balibar E. [1990], « La forme nation : histoire et idéologie », in Balibar E., Wallerstein I. (éd.), Race, Nation, Classe, les identités ambiguës, La Découverte. p. 117-143.
Benítez Rojo A. [1998], La isla que se repite, Barcelona, Editorial Casiopea.
Bonniol J-L. [1997], « Les sociétés humaines insulaires », in Îles vivre entre ciel et mer. Muséum National d´Histoire Naturelle, NATHAN, Chapitre 5, p. 72-87.
Plan de Ordenamiento Territorial (POT). [1998], Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.
Poutignat Ph et Steiff-Fenart J. [1999], Théories de l’ethnicité. Suivi de Les groupes ethniques et leurs frontières de Fredrik Barth. Paris, Presses Universitaires de France.
Ratter B. [2001], Redes caribes. San Andrés y Providencia y las Islas Caimán: entre la integración económica y la autonomía cultural regional, Bogotá, ICFES, Universidad Nacional de Colombia, sede San Andrés, Unibiblos.
Vasco L-G [s.d.], « Nacionalidad y etnocidio », in Politeia. Photocopies.
Wilson P. [1995], [1973], Crab Antics: a caribbean case study of the conflict between reputation and respectability, Prospect Heights, Waveland Press.

 Articles
Articles

 Anthropologies
Anthropologies