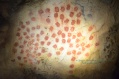Pour une confrontation
Aborder le dossier de l’identité et de la caractérisation archéologique de populations protohistoriques pour un espace géographique vaste et varié, comme celui de la Gaule méditerranéenne, implique la valorisation d’approches archéologiques, historiques mais aussi anthropologiques. Ainsi, Celtes et Ligures, Celto-ligures, voire Ibères du sud-est de la Gaule nécessitent maintenant d’être analysés comme le produit de contingences historiques et de processus sociaux, politiques et économiques, et non pas comme des entités immuables, des divisions stables de l’humanité (Amselle, M’Bokolo 1985 ; Poutignat, Streiff-Fenart 1995). Le théâtre de ces interactions sociales, culturelles et économiques ne doit pas, lui-même, être perçu comme un lieu découlant uniquement de rivalités inter- ou supra-ethniques et qui s’organise sous la forme d’un puzzle composé de pièces distinctes, à l’image de nos États-nations actuels (Foucher 1988), mais bien comme une somme de territoires empilés voire imbriqués, aux frontières fluctuantes, tant dans l’espace que dans le temps (Garcia 2002 ; 2004). C’est ce que nous allons tenter, en confrontant – pour la Gaule méditerranéenne – les sources archéologiques et historiques, et non sans avoir dressé, auparavant, un rapide bilan historiographique.
Rappel historiographique
En Europe, au XIXe siècle, le développement du nationalisme a entraîné l’utilisation dévoyée d’un grand nombre d’ethnonymes transmis par les sources écrites antiques ou médiévales (Geary 2004). Une très grande partie de la production historique européenne du xxe siècle a été guidée par cette approche étriquée de l’histoire des peuples. En effet, le concept de civilisation qui se répand à la fin du xixe siècle est directement appliqué par des chercheurs comme Heinrich Schliemann ou Arthur J. Evans à l’archéologie minoenne ou mycénienne. Mais c’est à la suite de la publication de l’ouvrage d’Edward. B. Tylor (1871) que sera diffusée l’équation (un peuple = une culture + un territoire) définissant le concept de culture et la diffusion d’objets spécifiques qui lui sont rattachés (les fossiles directeurs constituant tout ou partie de ce que nous appelons encore la culture matérielle : Cuche 2001 ; Julien, Rosselin 2005) et ne pouvant correspondre qu’à un peuple, ne se justifiant qu’en terme d’invasion, de migration ou de conquête… Cette analyse a pu conduire à des dérives nationalistes, voire raciales comme celles de Gustaf Kossinna (1911) : « Des provinces culturelles nettement délimitées sur le plan archéologique coïncident à toutes les époques avec des tribus ou des peuples bien précis ».
Pour la Protohistoire, en 1871, au cours d’une excursion organisée durant le 5e congrès d’anthropologie et d’archéologie préhistorique de Bologne, le Français Gabriel de Mortillet identifie des “Gaulois” à Marzabotto (Émilie-Romagne), en mettant en parallèle les armes et les parures de la nécropole (épées, pointes de lances en fer et fibules en bronze) avec le matériel trouvé en Champagne. C’est ainsi qu’il “invente” l’archéologie celtique. Avec lui se trouvait le Suédois Hans Hildebrand qui, en 1874, va proposer une terminologie de l’âge du Fer en Europe, scindée en deux phases chronologiques distinctes (le premier et le second âge du Fer) qu’il associe à deux cultures archéologiques nommées à partir d’espaces géographiques (Hallstatt en Autriche et La Tène en Suisse). Il est amusant de noter que c’est alors à l’influence de Marseille grecque qu’il attribuera le développement de la culture laténienne dans l’arc nord-alpin. En France, Joseph Déchelette dans son Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine (1908), va préciser la définition de cette culture qui lui semble directement issue de celle de Hallstatt. Il va évaluer son extension à partir de la répartition de la documentation archéologique tout en l’associant à la notion de civilisation, en l’occurrence celle des Celtes et des Gaulois, valorisée en 1894 par Henri d’Arbois de Jubainville dans son ouvrage Les premiers habitants de l’Europe. Joseph Déchelette localise le berceau des Celtes dans le bassin supérieur du Danube alors que Camille Jullian (1920-1926) situait leur origine en Allemagne septentrionale, dans la presqu’île et les îles danoises, et sur les côtes extrêmes de la mer du Nord.
Peu à peu, les Celtes seront définis comme un peuple pan-européen dont le berceau d’origine est placé sur l’arc nord-alpin et qui, au gré des invasions et des migrations, aurait rayonné sur une très grande partie de l’Europe centre-occidentale (Collis 2003a ; 2003b), alors que les textes anciens (en particulier Tite-Live, Histoire, V) ne mentionnent que l’expansion de certains groupes vers la péninsule Italique, la moyenne vallée du Danube ou les Balkans. Les déplacements de populations celtiques vers la façade atlantique, les îles Britanniques, le Midi de la Gaule ou la péninsule Ibérique – encore trop souvent évoqués – ne sont que des suppositions jamais confortées par les textes et largement contredites par l’archéologie. Elles ne font qu’accentuer la puissance d’un peuple celte, venant anéantir des tribus primitives, les Ligures en particulier. Dans cette démarche au parti pris idéologique fort, la Gaule méditerranéenne est trop souvent présentée comme un espace périphérique, une zone géographique et culturelle de confins dont les peuplades barbares ont été doublement colonisées, par les Grecs dès 600 avant J.-C. puis par les Celtes à partir du IVe s. av. J.-C.
Pour cette Gaule méditerranéenne, il faut attendre la seconde moitié du XXe siècle, avec l’ouvrage de Jean Jannoray (1955), pour qu’une synthèse, réalisée à partir du résultat des fouilles du site d’Ensérune (Hérault) dont l’auteur était le conservateur depuis 1942, s’interroge de façon critique sur l’identité des populations régionales. C’est un travail incontournable qui, sous couvert d’une étude monographique, présente les principaux problèmes et les rapports complexes qu’entretiennent les communautés du Languedoc et les commerçants méditerranéens. Notons, avec Danièle et Yves Roman (1997, p. 236), que « pour la première fois était (…) utilisé ce que les archéologues appellent couramment aujourd’hui le “faciès” d’une fouille, d’un lieu et l’identité de ses habitants. Non sans avoir étudié les textes antiques, Jannoray donnait ainsi la priorité à la culture matérielle ». Ces travaux, confirmés par la suite, révélaient une forte continuité dans le peuplement des principaux sites. À la même période, en revanche, sur cette même thématique, un chercheur comme J.-J. Hatt (en particulier Hatt 1958) tente d’illustrer archéologiquement, par la mise en évidence de couches d’incendies sur des sites bas-rhodanien (le Pègue, Soyons…) ou alpins (Sainte-Colombe…), les interventions militaires de populations celtiques au cours de migration. De temps à autre, ces propositions ont été reprises et, en plus de corrompre un dossier complexe, ont – dans un mouvement de raisonnement circulaire – entraîné la proposition de datations erronées : la destruction partielle ou totale des sites étant corrélée aux dates traditionnelles de ces interventions supposées… dans d’autres régions.
En 1969, Guy Barruol publie Les peuples préromains du sud-est de la Gaule. Étude de géographie historique. Une synthèse primordiale très marquée par la notion de régions naturelles, qui rassemble un corpus, quasi exhaustif, des textes anciens intéressant la Provence, les Alpes et le Languedoc, et des études monographiques sur les communautés régionales. C’est dans ce cadre historique rigoureux mais rassurant que s’inscrivent, à la même période, les travaux de terrain sur l’âge du Fer du midi de la France. Par leurs enseignements ou leurs travaux de terrain, les préhistoriens influencent alors sensiblement, directement ou indirectement, les approches techniques et scientifiques des jeunes protohistoriens qui vont développer de manière convaincante leurs propres problématiques et outils de recherche.
Si, dans les années soixante-dix, par l’analyse du cadre architectural et de leurs productions matérielles, l’étude des populations en elles-mêmes est au coeur de la démarche des chercheurs (marqués tout à la fois par les politiques internationales de décolonisation et par les mouvements régionalistes), la notion d’ethnogenèse est, quant à elle, totalement absente. Les communautés sont qualifiées “d’indigènes” et les “migrations celtiques” rapidement évacuées du débat : « il n’y a pas eu de civilisation purement celtique dans le sud de la Gaule » (Py 1974, p. 253). Cette approche sera pendant longtemps défendue : « Les Gaulois du Midi ne sont pas les Gaulois de tout le monde » (Py 1993). Cette tendance, dans sa forme plus que dans le fond, n’est pas sans rappeler une vision plus conservatrice, bien vivace avant-guerre, qui vantait l’originalité et la force des valeurs locales.
Les années quatre-vingt et quatre-vingt-dix sont marquées par un remarquable développement des fouilles des oppida en Provence et en Languedoc. L’analyse des rapports Grecs/indigènes rejette alors les concepts d’hellénisation et même d’acculturation pour porter un regard plus précis sur les processus d’assimilation culturelle et les termes des échanges commerciaux (entre autres : Arcelin 1992 ; 1995 ; Bats 1989 ; Chausserie- Laprée 2005 ; Dedet 1987 ; 1995 ; Gailledrat 1993 ; 1997 ; Gailledrat, Taffanel 2002 ; Garcia 1993 ; Nickels 1987 ; 1989 ; Py 1990 ; 1993).
C’est dans les actes du colloque du Tarente de 1997, consacré aux Confini e frontiera nella grecità d’occidente, que M. Bats (1999) renouvelle, grâce à une approche anthropologique, l’étude des populations protohistoriques méridionales. Alors que la même année, dans leur Histoire de la Gaule, D. et Y. Roman défendent la position d’incursions celtiques vers la Gaule méridionale au moins à partir du vie s. av. J.-C. : les Celtes sont une civilisation d’Europe du Nord et viennent supplanter les peuples autochtones (Ligures, Ibères et Aquitains).
En juin 2000, la tenue du 24e colloque international de l’AFEAF à Martigues permet de dresser un bilan des connaissances sur les espaces ethniques et les territoires des agglomérations protohistoriques de Gaule méridionale et, plus largement, d’Europe occidentale (Garcia, Verdin 2002). Depuis, plusieurs autres études analysant les entités ethniques du sud-est de la Gaule ont contribué à enrichir le débat (Arnaud 2001 ; Bats 2003 ; Boissinot 2005 ; Garcia 2004, p. 14-25 ; Py 2003) au même titre que différentes approches de la culture matérielle (cf. § 5), sans pour autant que les dossiers soient considérés comme clos.
Les espaces nommés
En nous appuyant sur une lecture des principaux documents littéraires anciens (Fontes Ligurum 1976 ; Barruol 1969 ; Duval 1971 ; Freeman 1996 ; Goudineau 2004 ; Pittia 2002), nous pouvons tenter de dessiner une carte des régions explorées et nommées par les Anciens, en commençant par l’espace ligure – longtemps présenté comme celui “du peuple originel” –, puis en évoquant celui des Ibères nord-orientaux et en abordant enfin le dossier de la Celtique méditerranéenne.
La Ligurie : du substrat ethnique à l’espace exploré
Le réexamen des différentes sources permet de faire évoluer sensiblement la perception des Ligures, traditionnellement considérés comme le substrat ethnique (un peuple originel) sur lequel, durant l’âge du Fer, d’autres populations (les Ibères, les Celtes…) sont successivement venues se superposer ou se mêler. C’est vers les Grecs qu’il faut sans doute rechercher l’origine du mot “Ligyen/Ligure” même si les Anciens, déjà, s’étaient interrogés en proposant des solutions plus ou moins fantaisistes : l’une des plus intéressantes est sans doute celle d’Étienne de Byzance selon lequel le terme dériverait d’un nom de fleuve, le Liguros, la généalogie fluviale étant un registre bien diffusé dans la tradition grecque. Les historiens du XXe siècle ont également cherché dans la direction d’une transposition du nom à partir des Ligures dits “orientaux” (le mot “ligure” étant aussi utilisé pour désigner des populations d’Asie) et Nino Lamboglia (1957) a quant à lui supposé une formation du terme sur une base indigène. La formation du mot “ligure” se serait étendue depuis les zones marécageuses du golfe du Lion sur une base préromaine *liga, signifiant “le marais”. Il avait noté le toponyme “Livière” (désigné Liguria par Grégoire de Tours au VIe s.) situé à proximité de Narbonne et a proposé une extension du terme à partir de cette région. Les Ligures seraient donc le peuple du marais comme Lattes (Latera) en Languedoc ou Arles (Arelate) en Provence sont les villes devant (are) le marais (late). Cependant, si le terme gaulois late (ou lati) est reconnu dans l’aire définie comme ligure – et plus largement dans le monde dit celtique – pour désigner le mot marais, la base préromaine liga proposée par Nino Lamboglia reste méconnue, même si l’on peut éventuellement la retrouver dans Liger (la Loire), fleuve dont l’étymologie reste énigmatique.
Récemment, Pascal Arnaud (2001) a remis en avant une hypothèse déjà avancée par Camille Jullian (1920-1926, p. 112, note 4) : le nom grec des Ligures ne serait pas la translittération ou l’homophonie approximative grecque d’un nom effectivement porté par un peuple indigène mais l’application d’un terme grec. Les Ligures (les Ligyens dans la transcription du grec) seraient, selon P. Arnaud, “les piailleurs” ou “les braillards”, et se seraient vus affubler d’un sobriquet dont le sens n’est pas très éloigné de celui des “barbares”. Plus précisément, selon nous, le terme lygies signifie “haut perché” : c’est effectivement le son de la harpe ou la voix des sirènes qui sont associés à ce mot dans les textes grecs archaïques (Hésiode, Théog., 275 ; 518). C’est donc cette caractéristique qui aurait été retenue par les Grecs et qui serait à l’origine de l’ethnonyme Ligyens (Ligures, chez les auteurs de langue latine). On pourrait donc en déduire que la Ligurie serait la région de la Celtique fréquentée par les Grecs : une bande littorale où le contact entre les Grecs et ces “Hommes à la voix haut perchée” serait direct. Nous sommes là bien loin des propositions d’Amédée Thierry (Histoire des Gaulois, 1866, p. 22-23) qui notait qu’au xvie ou xviie s. av. J.-C. « l’arrivée des Ligures en Gaule par les Pyrénées orientales fut le contrecoup de l’invasion gauloise opérée en Espagne par les Pyrénées occidentales ». Dans son Histoire de la Gaule (1920- 26), Camille Jullian quant à lui, suivait Roget de Belloguet (Ethnogénie gauloise, 1861) en affirmant le caractère indigène des populations ligures. Les savants qui ont confronté les données matérielles avec les sources littéraires se trouvaient davantage dans l’embarras. Joseph Déchelette notait de façon claire dans son Manuel d’archéologie préhistorique, celtique et gallo-romaine (1927, p. 150) : « Il résulte de l’ensemble de ces observations sur les tumulus hallstattiens de la région du Rhône que les sites funéraires des Ligures occupant alors ce territoire ne différaient guère de ceux des Celtes ». Et comme exemple parmi d’autres travaux d’aprèsguerre, l’analyse de Jean Jannoray (1955, p. 380) nous apparaît aujourd’hui extrêmement claire « (…) si les archéologues n’ont guère de peine, parmi les vestiges architecturaux et le matériel céramique ou métallique dont ils disposent pour faire l’étude des civilisations préromaines entre Rhône et Pyrénées depuis le premier âge du Fer, à marquer certaines similitudes avec la culture de la péninsule Ibérique ou à discerner les apports hallstattiens, ceux de la Tène et ceux du monde grec, ils se sont montrés impuissants jusqu’ici à dire en quoi consiste la part ligure, sauf à appeler de ce nom tout ce qui se révèle indigène (…) ». Auparavant, Albert Grenier (1940, p. 163) avait déjà noté la difficulté de distinguer les deux groupes, les Ligures étant par rapport aux Gaulois « presque de même langue qu’eux et de même origine (…) ».
On peut tenter une chronologie de cette Ligurie en tant qu’espace exploré, et son évolution en tant que territoire plus circonscrit. Pour cela, il faut, en premier lieu, remettre en avant un fragment épique attribué à Hésiode (VIIIe s. av. J.-C.), cité par Strabon (VII, 3, 7) d’après Eratosthène, évoquant : « Les Éthiopiens, les Ligyens et les Scythes qui traient les juments » (Fragment n° 55 Rzach 2). Dans cet extrait, les trois peuples mentionnés servent à marquer les limites du monde connu, dans le cadre d’une représentation spatiale de l’époque archaïque : les Éthiopiens au sud, les Scythes à l’est et les Ligures à l’ouest. Ce texte avait été retenu, anciennement (Arbois de Jubainville 1894, p. 11-12 ; Jullian 1920-1926, p. 110, 119) ou plus récemment (Barruol 1969, p. 148 et de manière plus nuancée p. 151) avant d’être, aujourd’hui, le plus souvent rejeté (par exemple dans Roman 1997 ; Arnaud 2001) à la suite, très certainement, de la position tranchée de P.-M. Duval (1971, p. 174) dans l’édition du volume des Sources de l’Histoire de France consacré à l’Antiquité. Pour ce dernier, la critique moderne devait retirer « ce fragment à Hésiode pour l’attribuer à un poète inconnu (…) depuis la découverte d’un papyrus égyptien attribué au iiie s., qui porte, à cette place du même vers, le nom des Libyens (…) ». Or, comme à plusieurs reprises chez P.-M. Duval, c’est sans doute la présence d’une mention aussi ancienne, gênante au regard des constats archéologiques connus à l’époque, qui incite à clore aussi fermement le débat. En effet, les chercheurs italiens, par exemple, moins enfermés dans une interprétation classicisante des sources anciennes et plus au courant de la documentation archéologique, utilisent sans gêne le fragment tel qu’il est attribué à Hésiode (par exemple, encore récemment, Gambari 2004 ; Colonna 2004). Ils considèrent simplement, dans le papyrus récent, la modification du gamma en bêta comme une erreur de transcription.
Des fragments d’Hécatée de Milet conservés dans l’Ethnika d’Étienne de Byzance, livrent également le mot “ligure”, en particulier les fragments 61 (« Élisyques : ethnos des Ligures. Hécatée dans l’Europe ») et 62 (« Massalia : ville de la Ligurie, en bas de la Celtique, colonie des Phocéens. Hécatée dans l’Europe »). Pour une date haute (la fin du vie s. av. J.-C.), nous avons là des attestations assez précises, reflets de hiérarchies ethniques (les Elisyques – communauté de la région de Narbonne – font partie des Ligures) et territoriales (Marseille est incluse dans l’aire ligure qui se trouve elle-même en Celtique), qui n’ont pas été suffisamment prises en considération. En effet, comme je l’ai déjà souligné, trop souvent influencés par les acceptions actuelles des notions géopolitiques, les auteurs modernes ont cherché à juxtaposer les informations ethniques ou territoriales puisées dans les textes anciens au lieu de privilégier la notion de territoires empilés ou imbriqués.
Pour la période postérieure, le Pseudo-Scylax (Périple 3, 4) qui date au moins du ive s. av. J.‑C. mais qui remonte peut-être à la fin du vie s., énonce : « 3. Ligures et Ibères. Après les Ibères, habitent les Ligures et les Ibères mêlés jusqu’au Rhône. La navigation le long des Ligures depuis Emporion jusqu’au Rhône est de deux jours et une nuit. 4. Ligures. Au-delà du Rhône suivent les Ligures jusqu’à Antion. Dans cette région se trouve la ville grecque de Massalia avec son port. (…).» La région côtière, du nord-est de la péninsule Ibérique au nord de la mer Tyrrhénienne, est ici divisée en trois espaces dont le peuplement de celui situé entre Pyrénées et Rhône a fait couler beaucoup d’encre. Pourtant, il reflète sensiblement un résultat majeur de l’analyse des données archéologiques recueillies dans ces régions depuis une vingtaine d’années : celui, à partir du VIIe s. av. J.-C., d’une ibérisation progressive du Roussillon et du Languedoc, stoppée vers 400 av. J.-C. par la fondation de la colonie grecque d’Agde, implantée à l’embouchure du fleuve Hérault qui confirmera ainsi son rôle d’espace de contact entre « la terre ibère et les rudes Ligures » (Avienus, Ora maritima, v. 612 ; Garcia 1993 ; 1995). Nous employons ici le terme “d’ibérisation” comme synonyme de développement progressif et de partage par les populations locales d’éléments culturels (dont la langue) et économiques (dont l’artisanat et l’agriculture) à la suite des échanges, essentiellement commerciaux, en l’occurrence ici avec la sphère phénico-punique, dont le Levant ibérique (Gailledrat 1993 ; 1997). Le fait que la colonie d’Agathé soit placée aux confins des deux espaces mais en tant que pion sur l’échiquier massaliète justifie, du point de vue de Grecs comme Étienne de Byzance, Euxode de Rhodes ou Philon de Byblos, de la localiser en Ligurie.
De la fin du VIIIe au IVe s. av. J.-C., ces textes nous donnent une image fluctuante de l’espace ligure. Du domaine étrusque aux colonnes d’Hercule (Colonna 2004), durant le haut archaïsme, la Ligurie peut être considérée comme une bande de terre littorale où les explorateurs méditerranéens ont un contact direct (de vive voix !) avec les populations locales. Dès lors, il nous semble que R. Dion (1959, p. 506) avait bien perçu le sens principal du terme en écrivant : « Ligure est le nom que les Grecs ont donné aux moins civilisés des peuples avec lesquels leurs entreprises colonisatrices en Méditerranée occidentale les ont fait entrer en contact. Sa valeur est comparable à celle du nom Indien dans la langue des colons modernes de l’Amérique.»
Pour la Gaule méditerranéenne, avec le développement de l’emporia massaliote et suite à l’émergence des cultures ibériques, elle se limitera à l’est de l’Hérault (puis du Rhône) pour se réduire à l’aube de la Conquête aux espaces alpins et périalpins peu investis par les commerçants marseillais (Bats 2003, pour les périodes récentes).
L’aire ibérique de Gaule méditerranéenne
Une racine hydronymique pré-celtique serait à l’origine d’Ibérus, nom de l’embouchure du rio Tinto mais aussi d’autres fleuves du nord-est de l’Espagne comme le Jucar et l’Ebre. Pour Eric Gailledrat (1997), qui suit en cela Alfonso Dominguez Monedero, le terme d’Ibérie a été progressivement appliqué par les géographes grecs à des fractions de plus en plus larges de la péninsule – du littoral oriental vers l’intérieur des terres –, au gré de l’évolution des explorations maritimes et des connaissances géographiques qui en découlent. Mais on peut suggérer que cette meilleure appréhension de l’espace s’est accompagnée d’une perception de plus en plus précise des productions régionales et des populations qui l’occupaient.
Il est donc temps de ne plus associer les Ibères avec de quelconques mouvements de populations comme on le fait encore parfois, même si ces propositions n’ont plus la vigueur de celles de Camille Jullian (Histoire de la Gaule, 1920-1926, p. 262-263) qui écrivait : « Cette descente de peuples espagnols vers les plaines de la Gaule est un fait aussi constant dans notre histoire nationale que le passage du Rhin par les immigrants des basses terres germaniques. (…) Ces malheureux Ligures allaient donc être traqués dans le sud comme ils l’avaient été dans le nord. Ils furent presque partout dans le monde, aussi bien en Gaule et en Espagne qu’en Italie et dans les îles Britanniques, la matière humaine sur laquelle s’exercèrent tous les peuples conquérants du dernier millénaire avant l’ère chrétienne.» C’est le même schéma que suivait Henri Hubert (Les Celtes et l’expansion celtique jusqu’à l’époque de la Tène, 1932, p. 363) : « quelques dizaines d’années après l’invasion celtique, les Ibères de la vallée de l’Ebre ont gagné vers le nord aux dépens des Ligures. Ils ont vraisemblablement organisé contre ceux-ci des expéditions militaires et ils ont fait une guerre de destruction.»
En effet, les communautés du sud, puis du littoral oriental de la péninsule, ont des relations avec les navigateurs et des commerçants phéniciens dès le VIIIe s. av. J.-C., puis grecs à partir du VIIe s. av. J.-C. Des contacts – directs ou indirects – sont perçus au-delà des Pyrénées en Roussillon et jusqu’en Languedoc, à l’ouest de l’Hérault. Ce sont eux qui sont à l’origine de la formation de ce que les archéologues nomment la culture ibérique, particulièrement florissante par son art, ses productions artisanales mais aussi sa langue (transcrite à l’aide d’un alphabet adapté du phénicien et du grec) durant les vie-iiie s. (Catalogue 1997). À partir du viie s. av. J.-C., en Gaule méditerranéenne, le développement de la culture ibérique peut être considéré comme une extension d’un mouvement commercial, initié sur le littoral de la péninsule et qui localement vient se surimposer aux cultures antérieures.
Une Celtique Méditerranéenne
Dans l’état actuel de nos connaissances, l’étymologie du terme Keltiké – dont l’origine celtique est improbable – reste obscure. Au début du premier âge du Fer et sans doute même plus tard, il est fort vraisemblable que tout ou partie des populations concernées ne devait pas se définir comme “celtique” et n’avait certainement pas l’impression d’appartenir à un groupe aussi large que celui qu’évoquent les textes, dès une période haute, du Détroit de Gibraltar (Moret 2004, p. 116) au centre de l’Europe, ou même que celui que traditionnellement les archéologues circonscrivent. Dès 1987, Colin Renfrew avait attiré l’attention sur l’importance d’un passage de Strabon (IV, 1, 14) : « Voilà ce que nous voulions dire des peuples qui occupent la province Narbonnaise. On les appelait autrefois Celtae et c’est, je pense, la raison pour laquelle les Gaulois dans leur ensemble sont connus par les Grecs sous le nom des Celti, soit que ce nom fût plus illustre, soit aussi que l’influence notamment des Massaliotes, proches voisins de la Narbonnaise, ait contribué à le faire prévaloir ». Colin Renfrew (1987, p. 264) souligne que : « Il est tout à fait plausible que les premiers Barbares à avoir eu des contacts avec la population grecque de la colonie de Massalia (Marseille) aient appartenu à une tribu dont l’ethnonyme était Keltoi ou son équivalent. Les Grecs auraient alors étendu l’emploi de ce terme à tous les Barbares de la région. L’histoire sous-entend en effet que les habitants ne se désignaient pas eux-mêmes comme “Celtes”, mais qu’il s’agissait d’un ethnonyme imposé de l’extérieur.»
En effet, dans le mouvement d’exégèse sur la sémantique et l’origine des mots, les géographes et historiens grecs ont cherché à expliquer les noms des peuples installés en Gaule, en Ibérie et en Germanie. Ces explications s’appuient généralement soit sur un mythe fondateur, autour de personnages légendaires, soit sur une interprétation linguistique du terme étudié. Dans tous les cas, il s’agit d’intégrer des réalités étrangères à la perception grecque du monde, de récupérer ce qui pourrait apparaître comme échappant à leur interprétation cosmogonique. Les deux ethniques Celte et Galate sont assimilés l’un à l’autre au moins à partir du ier s. av. J.-C., notamment dans le Bellum Gallicum de César (I, 1) : « …le peuple qui, dans sa langue, se nomme Celte et, dans la nôtre, Gaulois. ». D’après la documentation dont nous disposons, c’est à partir du Ve s. av. J.-C. que la tradition grecque propose une explication de ces termes et l’interprétation se diversifie jusqu’à l’époque byzantine.
Avec Sophie Collin-Bouffier, nous avons analysé ces notions dans une étude récente (Collin-Bouffier, Garcia à paraître). Il ne s’agit donc ici que d’un simple rappel. Il existe d’abord une version étymologique du mot Celte. D’après Denys d’Halicarnasse qui inventorie toutes les étymologies connues de Celtos (Antiquités romaines, 14, A) : « D’autres encore affirment que les premiers Grecs qui se transportèrent jusqu’à ce pays virent leurs bateaux, emportés par un vent violent, aborder dans le golfe Galate ; lorsqu’ils touchèrent au rivage, les hommes appelèrent la terre du nom de leur mésaventure, Celsique (“terre abordée”), puis la postérité la nomma Celtique, en changeant une seule lettre.» Le substantif proviendrait ici d’un jeu de mots fondé sur le verbe grec “kellein”, qui signifie aborder. Dans cette version que nous avons récemment adoptée (Garcia 2004), plus pour son intérêt heuristique que par simple conviction, la Celtique est donc perçue comme un espace s’étendant du littoral de la Méditerranée nord-occidentale vers l’intérieur du continent européen. C’est donc une vision diamétralement opposée à celle privilégiée dans l’historiographie récente, où la civilisation celtique est présentée – contre toute argumentation archéologique étayée – comme endémique à l’Europe centrale, berceau initial générant des métastases au gré de migrations successives.
Les autres versions recensées par la tradition grecque ont des fondements beaucoup plus idéologiques. La plus neutre en apparence est celle que suggère Denys d’Halicarnasse : « Les Grecs la désignent tout entière par le nom commun de Celtique, qui lui vient, selon certains, d’un géant, Celtos, autrefois souverain du pays.» Elle est comparable aux mythes connus pour les contrées barbares où règnent des souverains étranges, au physique et au comportement non-grecs, contre lesquels les héros grecs sont parfois obligés de lutter. On pourrait associer à ces deux dernières versions une troisième variante, donnée encore par Denys d’Halicarnasse et qui fait appel à un autre registre également bien diffusé dans la tradition grecque : « D’autres enfin disent que Celtos est un fleuve qui sort des Pyrénées et que c’est de lui que la contrée voisine d’abord, et ensuite le reste du pays, a été, avec le temps, appelée Celtique.» En effet, depuis Homère, on connaît l’existence de généalogies fluviales, qui font des familles régnantes les autorités légitimes de la région. Elles traduisent la volonté de la part des aristocraties locales de défendre leur autochtonie, base du pouvoir dans ces sociétés sédentaires. Affirmer que les Celtes sont issus du sol même de leur terre par le biais d’un fleuve qui jaillit des profondeurs de Gaia, c’est légitimer leur présence dans la région, avant de les unir par des mariages à des Grecs de passage.
La quatrième version offerte par les textes grecs est la plus originale et doit être vraisemblablement lue dans un contexte spécifique : les rapports entre la Gaule et la Sicile. À partir du Ve s. av. J.-C., un mythe généalogique met en relation les deux régions. D’après le recueil byzantin de l’Etymologicon Magnum, Timée de Tauroménion, au IVe-IIIe s., raconte que le Cyclope Polyphème et la nymphe Galatée eurent un fils nommé Galatos, qui donna son nom au pays (Jacoby, FGrH, 3B, n° 566, F69, p. 621). Logiquement, on peut soupçonner le patriotisme de Timée, lui-même originaire des lieux où est localisée la légende du Cyclope et de la nymphe, sous l’Etna, aux abords des rochers de Tauroménion et de Naxos. Les rapports entre Grecs de Sicile et Celtes à l’époque de Denys l’Ancien ont été anciennement analysés : à la fin du ve s., le tyran de Syracuse a recours à des mercenaires celtes et la version de Timée rendrait compte des liens militaires qui se mettent en place à ce moment-là. Même si le mythe n’est attesté qu’à partir du ive s. dans notre documentation littéraire, il faut vraisemblablement faire remonter à une date plus ancienne les relations entre Celtes et Siciliotes : en particulier, la place des échanges entre le Midi et la Sicile à l’époque archaïque, sans doute très largement sous-estimée au profit du trafic avec l’Étrurie ou la Grèce de l’Est, comme nous l’avons récemment suggéré (Collin-Bouffier, Garcia à paraître ; Garcia, Vital 2006).
Les Celto-Ligures
Comme nous venons de le voir, de part la promiscuité entre diverses communautés et le développement de réseaux liés aux activités commerciales et coloniales, le Midi méditerranéen constitue un espace de confrontations interethniques que soulignent les textes anciens et précisent les données archéologiques. Le Périégèse du Pseudo-Scymnos (v. 199-219) dont les sources remontent au IVe s. nous donne une bonne description de la Ligurie, que d’Emporion aux Tyrrhènes, il désigne comme côtière. Auparavant, le même auteur cite la Celtique à la suite des Ibères (v. 167) et fait des Celtes le peuple le plus important d’Occident. On trouve également ici cette notion de territoire empilé : la Ligurie est un espace littoral de la Celtique. Plus tard, Polybe localise les Ligures de Marseille à Pise, dans ce qu’il appelle l’Apennin mais qui comprend les Préalpes et les premières hauteurs situées au nord de Marseille. Il relate également que les Marseillais appelèrent Rome à l’aide contre les Ligures (XXXIII, 7-8) ; c’est alors que deux tribus au nom d’origine celtique (les Oxybiens et les Déciates) sont nommées. On retrouve ce même type de précision chez Pline (Histoire naturelle III, 47) lorsqu’il nous donne la liste des groupes ligures d’extrême Occident : « Ligures les plus célèbres : au-delà des Alpes, les Salyens, les Déciates, les Oxybiens.» Ils apparaissent déjà dans la Géographie (IV, 6, 3) de Strabon quand il nous dit : « Les anciens Grecs appellent Ligures les Salyens, et Ligurie la région qu’occupent les Massaliètes ; les Grecs postérieurs les nomment Celto-Ligures, et leur attribuent en outre la plaine jusqu’à Luério (le Luberon) et jusqu’au Rhône.» Logiquement, Strabon “actualise” des données plus anciennes. Il nous dit que les Salyens, maintenant reconnus comme tels, étaient anciennement inclus sous l’appellation de “Ligures”, et que c’est le terme de “celto-ligure” qui est utilisé par les Grecs de son temps (Arnaud 2001 ; Bats 2003). La dénomination “celto-ligure” a souvent été interprétée comme une notion de mélange. Cet aspect a fréquemment été exploité par certains auteurs modernes voulant appuyer l’hypothèse que, durant le deuxième âge du Fer, les populations de “souche ligure” ont été enrichies d’importants apports humains et culturels de la part des Celtes dits historiques. Or, il semble en l’occurrence, et sans en faire une règle absolue, qu’ici le premier élément du nom a valeur d’un adjectif, le second d’un substantif qui seul désignerait l’origine ethnique. Les Celto-Ligures seraient donc les Ligures de la Celtique. On retrouve ici, sous une variante de “au-dessus” ou “parmi”, le mode de description des auteurs plus anciens. Comme nous l’avons proposé, les Ligures sont les indigènes avec qui les Grecs ont des contacts directs : ils occupent un espace d’interface, une zone pacifiée qui facilite les communications – donc le commerce – vers les régions périphériques.
Pour la Celtique méditerranéenne, les sources écrites les plus récentes – en particulier Pline (Histoire Naturelle, 3, 31-37) et Strabon (IV) – nous livrent une liste importante de “peuples” qui occupent généralement un territoire restreint, autour d’un oppidum. Bien entendu, il s’agit davantage là d’une meilleure connaissance et gestion de l’espace, liée à la Conquête, que d’un réel morcellement des communautés antérieures. Egalement citées, les entités ethniques plus étendues (les Volques Tectosages en Languedoc occidental, les Volques Arécomiques en Languedoc oriental, les Salyens en Provence occidentale, les Cavares dans la région d’Avignon, les Voconces autour de Vaison…) représentent des confédérations ethniques découlant de réseaux économiques antérieurs, de centres religieux confédéraux ou encore d’alliances militaires…
Identité celtique et culture matérielle : quelques propositions
Comme nous l’avons vu dans notre bref rappel historiographique, l’archéologie celtique doit beaucoup à Hans Hildebrand qui, en 1874, va distinguer un premier d’un second âge du Fer et associer ces deux phases à deux cultures archéologiques nommées à partir d’espaces géographiques (Hallstatt et La Tène). Ces deux faciès successifs étant décrits, localisés et attribués aux Celtes (avec quelques nuances pour le faciès hallstattien qui, par la suite, pourra être considéré comme “préceltique”), les recherches des successeurs d’Hildebrand vont s’attacher – jusqu’à nos jours et dans la plupart des cas – à mesurer la part de “celtisme” dans les faciès contemporains, des plus proches aux plus périphériques des sites éponymes, et – le plus souvent – d’associer ce degré de “celtisme” à des apports humains (les “migrations” des Anciens). On perçoit là une double analyse linéaire de la civilisation celtique : historique (des premières mentions textuelles à la guerre des Gaules) et géographique (du centre vers la périphérie). Chacun des faciès reconnus constitue alors la pièce d’un puzzle représentant les territoires celtiques dont l’image s’élargirait et se préciserait au cours du temps : le foyer initial donnerait progressivement naissance à un empire, effaçant tout ou partie des traces des communautés antérieures. Il s’agit là d’une approche évolutionniste, caractéristique dans l’histoire des sciences de la deuxième partie du xixe siècle et des deux premiers tiers du xxe siècle. Cette démarche est en opposition avec celle que nous avons rappelée en début de notre étude et qui privilégie une lecture dynamique (les “territoires empilés ou imbriqués”) de la documentation.
Aussi est-il souhaitable d’avantager une représentation cladistique des faciès dans laquelle ceux de la Gaule méditerranéenne seraient inclusifs de la civilisation celtique : une image en arborescence des cultures matérielles qui, on l’aura compris, ne permet plus de considérer le sud-est comme un espace celtique périphérique mais bien comme une aire culturelle ouverte et dynamique, espace d’innovation et d’intégration. Ainsi, les différents éléments marqueurs de la culture celtique n’apparaissent pas comme moins nombreux en Gaule méditerranéenne que dans le reste de l’Europe occidentale, mais ils sont ici associés à d’autres realia, issus des trafics méditerranéens et à des productions régionales découlant de ces contacts commerciaux.
Au début du premier âge du Fer (d’environ 725 à 625 avant J.-C.), on reconnaît quatre grands ensembles culturels en Gaule méditerranéenne (Garcia, Vital 2006, fig. 6-7) : le faciès Grand-Bassin 1 à l’ouest de l’Hérault, le faciès suspendien en Languedoc oriental et au-delà, jusqu’aux Alpilles, un faciès de la Provence occidentale et un faciès bas-alpin. Le faciès Grand-Bassin 1 est marqué par une évolution sensible des formes céramiques issues du Mailhacien I du Bronze final IIIb à partir, en particulier, d’influences phénico-occidentales : urnes à grand col ou à panse à carènes multiples, vases chardon ou à pied haut… (Nickels, Marchand, Schwaller 1989 ; Gailledrat 1997 ; Janin 2002). Le mobilier métallique traduit le même phénomène ainsi que le rattachement de ces groupes à la sphère pyrénéo-aquitaine : fibules à arc serpentiforme, rasoirs en croissant, boutons coniques, couteau en fer… Le faciès céramique suspendien, de la vallée de l’Hérault aux Alpilles, trouve lui aussi son origine directe dans le faciès Mailhacien I mais trahit également de légères influences méditerranéennes (trafic commercial étrusque et grec) et éventuellement septentrionales : urnes sans col ou à panse surhaussée et col bas, coupes hémisphériques ou tronconiques… Le mobilier métallique peut être caractérisé par les fibules à bouton terminal conique, les bracelets filiformes, les scalptoriums, les pendeloques triangulaires… (Py et al. 1984). Le faciès céramique de la Provence occidentale est moins marqué par les influences méditerranéennes. Il présente encore des liens nets avec les sphères rhodanienne et hallstattienne : urnes basses et carénées à décor incisé, coupes-couvercles à pied… Les objets métalliques caractéristiques sont proches de ceux rencontrés en Languedoc oriental (Bats 1989). Les cultures de la moyenne vallée du Rhône et du centre occidental de l’Europe marquent nettement le domaine bas-alpin dont le référentiel doit encore être enrichi pour en affiner la lecture. Cette période est également caractérisée par les premières importations méditerranéennes : étrusques, de Grèce de l’Est mais également de Sicile. Ce sont alors les faciès de la Provence occidentale et des Basses-Alpes, et dans une moindre mesure, celui du Languedoc oriental, qui semblent se rapprocher le plus des ensembles plus continentaux, qualifiés d’hallstattiens. Mais il serait somme toute schématique, comme on le fait parfois, d’établir une équation directe entre le faciès hallstattien (continental) et un espace ethnique celtique. Car si ce faciès homogène est, clairement, géographiquement central, il n’en est pas pour autant dynamique.
À partir de la phase 625/600-525, à la suite du développement du commerce emporique qui touche alors tout l’arc nord-occidental de la Méditerranée, puis de la fondation de Massalia, ces quatre faciès régionaux vont être amendés. Les importations phénico-occidentales atteignent essentiellement le Roussillon et le Languedoc occidental jusqu’à hauteur de l’Hérault, alors que les produits étrusques et grecs sont plus présents en Languedoc oriental et en Provence. Ce sont essentiellement des amphores vinaires associées à des vases du service à boire : céramiques ibériques, bucchero nero étrusque, vases de Grèce de l’Est ou attiques. Quelques céramiques grecques d’Occident, en particulier des imitations en pâte claire des coupes ioniennes b2 et des formes ouvertes en céramique grise monochrome de fabrication régionale, complètent ce type de mobilier. Les importations ne viennent pas remplacer les vases indigènes mais correspondent à un besoin nouveau, celui de la consommation du vin. Le taux de céramique non tournée reste encore très fort, en particulier à l’est de l’Hérault : fréquemment près de 90 % du mobilier, le plus souvent lié à la préparation et la consommation des repas et au stockage des denrées alimentaires. Les formes, au profil plus adoucies, découlent de celles de la phase antérieure.
Entre environ 525 et 450/400 avant J.-C., la structuration des réseaux commerciaux méditerranéens accentue la différentiation des cultures matérielles. Dans la région de Lattes et dans une partie du Languedoc oriental, les produits étrusques demeurent bien présents jusqu’au début du ve s. av. J.-C. (Py 1995) alors que plus à l’est, ce sont les amphores de Marseille et des vases à boire associés qui vont s’imposer de façon quasi exclusive. Dans la basse vallée de l’Hérault et en Languedoc occidental, ce commerce massaliote se trouve associé aux effets du trafic commercial en provenance de la péninsule Ibérique. Cette période se caractérise aussi par de nombreuses créations d’ateliers micro-régionaux de céramiques tournées : céramiques à pâte claire et grise monochrome en Languedoc oriental et en Provence, céramiques grises monochromes et ibéro-languedociennes en Roussillon et en Languedoc occidental. Seules les jarres pithoïdes ibéro-languedociennes, issues de certains de ces ateliers, ne sont pas directement destinées au service de table. Pour cet usage, de rares importations attiques et des vases massaliotes en pâte claire viennent compléter les productions régionales. Dans toute la région prise en compte, le pourcentage de céramiques non tournées est en baisse sensible – parfois même inférieur à 50 % de la totalité des vases (en particulier en Languedoc occidental) – mais, en réalité, jattes, coupes et urnes modelées sont presque aussi nombreuses qu’auparavant.
Si quelques vases en bronze étrusques, des bassins en particulier, sont recensés à la fin du viie siècle et durant le vie siècle, la quasi-totalité du mobilier métallique, encore essentiellement en bronze, reste de fabrication locale. Dans la parure, les bracelets filiformes viennent remplacer les exemplaires plus massifs des périodes antérieures et sont associés à des fibules à pied relevé en angle droit et à bouton terminal conique. En Gaule méditerranéenne, les armes en fer pourraient être rapprochées d’une typologie hallstattienne comme les épées à antennes à poignées à soie ; les cnémides et les javelots en fer de type soliferrea accompagnés des plaques boucles à crochet sont eux les témoignages originaux de la panoplie du guerrier, du Roussillon à l’Hérault.
La phase 450/400-125 marque le deuxième âge du Fer ; c’est sans aucun doute la phase culturelle la plus difficile à synthétiser. En Provence occidentale, les urnes en céramique non tournée évoluent vers des formes plus trapues alors que les coupes sont le plus souvent remplacées par des vases tournés, importés (céramiques italiques d’Étrurie méridionale, de Campanie ou de Rome) ou de fabrication régionale (pâtes claires). Le vin, toujours presque exclusivement massaliote au début de la phase, va entrer en concurrence, à partir de la fin du IIIe s., avec des importations italiques. Le mobilier métallique, le plus souvent de fabrication locale, peut pourtant être rapproché du matériel de typologie laténienne, y compris des objets originaux comme les bracelets à nodosités saillantes de type Teste-Nègre ou des fibules à incrustation de corail. L’usage de la parure en verre (perles et bracelets en particulier) se répand. Mais c’est aussi le cas de l’armement même si, pour cette catégorie, les correspondances avec les armes laténiennes sont plus directes. En Languedoc oriental, domine un faciès rhodanien (Py 1993) essentiellement marqué par la céramique non tournée, en particulier des urnes à panse peignée. Si Marseille domine le marché de la diffusion de vin aux ive et iiie s., la place de l’Italie devient prépondérante dès le iie s. La parure et l’armement développent des caractères laténiens extrêmement nets. Pour le Languedoc occidental, il est intéressant d’aborder le cas du site ibérolanguedocien d’Ensérune (Hérault), situé entre Narbonne et Béziers, dont une étude récente (Schwaller 2001), réalisée à partir de l’analyse d’ensembles funéraires, a montré toute la complexité du faciès local et son évolution pendant le deuxième âge du Fer. Dès le ve s., les armes (épées, fourreaux…) et la parure (agrafes, fibules…) trahissent l’appartenance du mobilier métallique à un faciès laténien sur ce site ouvert sur la Méditerranée, comme en témoignent l’abondance et la qualité des céramiques importées dont certains types ont influencé les productions locales. Les panoplies de guerriers du ive s. sont en tous points semblables à celles que l’on retrouve dans le reste de l’espace celtique, sans retard dans l’adoption des types et sans modification importante. Dès le ive s., des graffites ibériques sont réalisés sur des céramiques. Certains mentionnent des noms celtiques ibèrisés (Catalogue 1997, p. 268).
L’évocation de certaines caractéristiques de la culture matérielle en usage en Gaule méditerranéenne durant l’âge du Fer peut permettre, littéralement, de matérialiser une culture qui logiquement ne peut être observée directement. Mais en définissant, à partir des assemblages d’objets archéologiques, la diversité et l’évolution de certaines caractéristiques sociales, économique et/ou culturelles, il serait vain – voire néfaste – d’y associer des appartenances ethniques directes.
C’est donc probablement à partir de la deuxième moitié du VIIe s. av. J.-C., lorsque les explorateurscommerçants grecs abordent les côtes du golfe du Lion, que les populations de la Méditerranée nordoccidentale seront qualifiées de Ligures tandis que l’espace abordé sera nommé la Celtique. Ce dernier terme sera étendu, petit à petit, à une très grande partie de l’Europe centrale et occidentale. En ce sens, il n’est pas opportun de qualifier la Gaule méditerranéenne d’espace celtique périphérique. Même si, dès la fin du VIIIe s. av. J.-C., avec l’apparition des premiers objets en fer, puis le développement de la sidérurgie, on note un net développement socio-économique, celui-ci n’a pas d’incidence ethnique décisive. Des communautés que l’on peut qualifier de tribus exercent alors un contrôle sur un territoire restreint (quelques milliers de km2), une ou plusieurs vallées – comme les Élisyques en Languedoc –, un plateau ou un petit bassin, à l’instar des Ségobriges.
Cette communauté provençale du premier âge du Fer est mentionnée dans les textes (Justin d’après Trogue-Pompée, Abrégé des Histoires Philippiques, XLIII, 3), car c’est sur leur territoire que, selon la légende, les Phocéens, en 600 avant J.-C., « fondèrent Marseille parmi les Ligures et les peuples sauvages de la Gaule ». L’origine celte du nom des Ségobriges ne fait pas de doute : il est fait référence à la “victoire” (sego-) mais aussi à la “force” (brigo-). Une hiérarchie spatiale est bien présente : la ville grecque est créée (du littoral vers l’hinterland) sur le territoire des Ségobriges, parmi les Ligures chez les Gaulois.
L’accroissement des échanges commerciaux et la mise en place des réseaux d’habitat vont déboucher sur la mise en place d’aires économicoculturelles, ferments des essors ethniques, ibères et ligures en particulier. L’ethnicité apparaît ici comme un phénomène social et psychologique associé à une construction culturelle et une dynamique économique. L’espace maîtrisé sera dorénavant nommé : la Celtique – l’espace abordé – comme concept géographique, ou la Ligurie – l’espace fréquenté –, lieu d’échange et de confrontation. Au cours du deuxième âge du Fer, l’évolution interne des groupes indigènes et les enjeux géopolitiques des sociétés classiques vont déboucher, chez les Celtes méditerranéens, sur la mise en place de confédérations, à l’image de celle des Salyens pour la Provence occidentale.

 Articles
Articles

 Anthropologies
Anthropologies